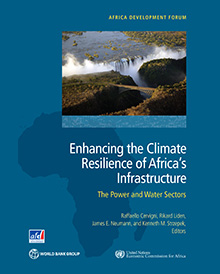 Dans moins d’une semaine, les dirigeants de plus de 190 pays se retrouveront à Paris pour finaliser un nouvel accord visant à éviter un réchauffement de l’atmosphère terrestre supérieur à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
Dans moins d’une semaine, les dirigeants de plus de 190 pays se retrouveront à Paris pour finaliser un nouvel accord visant à éviter un réchauffement de l’atmosphère terrestre supérieur à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
Plus que jamais, la question de l’adaptation sera au centre des discussions. En convenant de contenir la hausse des températures à 2 °C, les négociateurs reconnaissent que le dérèglement climatique est inévitable : l’atmosphère est condamnée à se réchauffer. Il faut donc s’adapter et mobiliser les ressources nécessaires pour aider les pays les plus pauvres à opérer une transition indispensable.
Quelle est la marche à suivre ? C’est là une question difficile. Si les solutions techniques permettant de réduire les émissions sont bien connues, il n’en est pas de même pour l’adaptation : dans ce domaine, l’on a beaucoup plus de mal à se déterminer sur les choix de développement auxquels il faudrait procéder face au changement climatique anticipé.
Prenons l’exemple des investissements de long terme dans les infrastructures. Les concepteurs de projets doivent décider aujourd’hui de la manière de construire une centrale hydroélectrique, un dispositif d’irrigation ou une route : quelles capacités de production électrique faut-il viser ? Combien d’hectares faut-il irriguer ? Quelle épaisseur d’asphalte faut-il prévoir ? Ces arbitrages sont essentiels, parce qu’ils déterminent l’aptitude du projet à rester utile même dans des conditions climatiques futures et donc encore inconnues. Un mauvais choix et les solutions préconisées seront inadaptées à l’évolution du contexte. Avec le risque de gâcher de précieuses ressources financières et de passer à côté d’opportunités de développement. Toutes ces considérations sont particulièrement pertinentes pour l’Afrique. En 2010, le Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (qui a débouché sur la publication du premier rapport de la collection « Africa Development Forum », intitulé Infrastructures africaines : une transformation impérative) a estimé à 93 milliards de dollars le besoin annuel d’investissements pendant pas moins de dix ans pour combler le retard infrastructurel du continent. Le Programme de développement des infrastructures en Afrique, approuvé en 2012 par les chefs d’État et de gouvernement africains, expose un ambitieux plan de long terme pour remédier à ces lacunes, en tablant notamment sur une augmentation sensible des capacités de production d’hydroélectricité et de stockage de l’eau. Le changement climatique viendra-t-il contrarier ces projets et comment ?
Toutes ces considérations sont particulièrement pertinentes pour l’Afrique. En 2010, le Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (qui a débouché sur la publication du premier rapport de la collection « Africa Development Forum », intitulé Infrastructures africaines : une transformation impérative) a estimé à 93 milliards de dollars le besoin annuel d’investissements pendant pas moins de dix ans pour combler le retard infrastructurel du continent. Le Programme de développement des infrastructures en Afrique, approuvé en 2012 par les chefs d’État et de gouvernement africains, expose un ambitieux plan de long terme pour remédier à ces lacunes, en tablant notamment sur une augmentation sensible des capacités de production d’hydroélectricité et de stockage de l’eau. Le changement climatique viendra-t-il contrarier ces projets et comment ?
Un ouvrage récent (a) offre quelques pistes en la matière, qui étudie des solutions pour renforcer la résistance des infrastructures énergétiques et du secteur de l’eau de l’Afrique. En faisant appel pour la première fois à une méthode cohérente reposant sur un large éventail de scénarios à la pointe de la technologie, les auteurs évaluent l’impact du changement climatique sur les projets de développement de l’hydroélectricité et de l’irrigation dans les grands bassins fluviaux de l’Afrique (Congo, Niger, Nil, Orange, Sénégal, Volta et Zambèze) ainsi que sur le secteur de l’électricité dans quatre pools énergétiques (Afrique de l’Ouest et de l’Est, Afrique centrale et Afrique australe).
Ils montrent ainsi que l’incapacité à intégrer le changement climatique dans la planification et la conception d’infrastructures électriques et hydrauliques pourrait, dans les pires scénarios de sécheresse, entraîner un important manque-à-gagner en matière d’hydroélectricité et une hausse des dépenses d’énergie pour les consommateurs. Tandis que dans les scénarios d’humidité maximale, la poursuite des politiques actuelles de développement des infrastructures pourrait entraîner de fortes pertes de recettes dès lors que ce volume supérieur de précipitations n’est pas exploité pour accroître la production d’hydroélectricité. Selon nos estimations, le manque-à-gagner lié à une sécheresse maximale pourrait se situer entre 5 et 60 % par rapport aux valeurs de référence (selon les bassins fluviaux concernés), entraînant jusqu’à un triplement des dépenses de consommation provoqué par une production hydroélectrique moins abondante. Dans le scénario d’humidité maximale, les pertes s’échelonneraient de 15 à 130 % par rapport aux valeurs de référence. Pour l’irrigation, les pertes maximales prévues tournent entre 10 et 20 % pour la plupart des bassins. Dans le scénario d’humidité maximale, les gains non réalisés se situent entre 1 et 4 %, à l’exception du bassin de la Volta où les pertes seraient d’un ordre de grandeur supérieur.
Cela signifie-t-il que, du fait du changement climatique, l’Afrique doit ralentir ses investissements dans les infrastructures ? C’est tout le contraire : plus ils auront des infrastructures solides, plus les pays africains seront capables de résister à cette évolution. Mais les projets de long terme doivent intégrer le facteur du changement climatique, dès les premières phases de la planification et jusqu’aux étapes ultérieures d’études de faisabilité et de conception.
Dans le cas de l’hydroélectricité, l’intégration du changement climatique dans la planification des investissements peut réduire de moitié (voire plus) l’impact le plus catastrophique envisagé (pertes de revenus ou incapacités de saisir l’occasion d’augmenter les recettes) faute d’avoir prévu ces évolutions. L’analyse montre en outre que les gains obtenus sur le plan de la réduction des risques sont largement supérieurs aux coûts liés à la modification des programmes d’investissement de référence dans la quasi-totalité des bassins étudiés. Seul le bassin du fleuve Congo fait exception, puisque les prévisions climatiques tablent sur une évolution minimale du régime hydrologique actuel, ce qui rend l’argument économique en faveur d’une révision des plans moins convaincant.
Comment dès lors développer des infrastructures à l’épreuve du climat en Afrique ? Si les instruments dont on a besoin se généralisent aujourd’hui, ils ne suscitent encore qu’une confiance insuffisante chez ceux qui doivent les utiliser. Il faut redoubler d’efforts pour réunir les concepteurs de projets, les scientifiques du climat et les organismes de financement, afin de permettre une action concertée face au défi de l’adaptation. La Banque mondiale travaille avec la Commission de l’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique dans le but de trouver une solution. Nous avons à cet effet prévu de soumettre aux participants de la COP21 le principe d’un mécanisme de financement pour des investissements à l’épreuve du climat en Afrique. Pour en savoir plus, suivez le fil...
Le développement vous intéresse? RDV sur le blog idées pour le développement, animé par l’Agence française de développement (AFD).